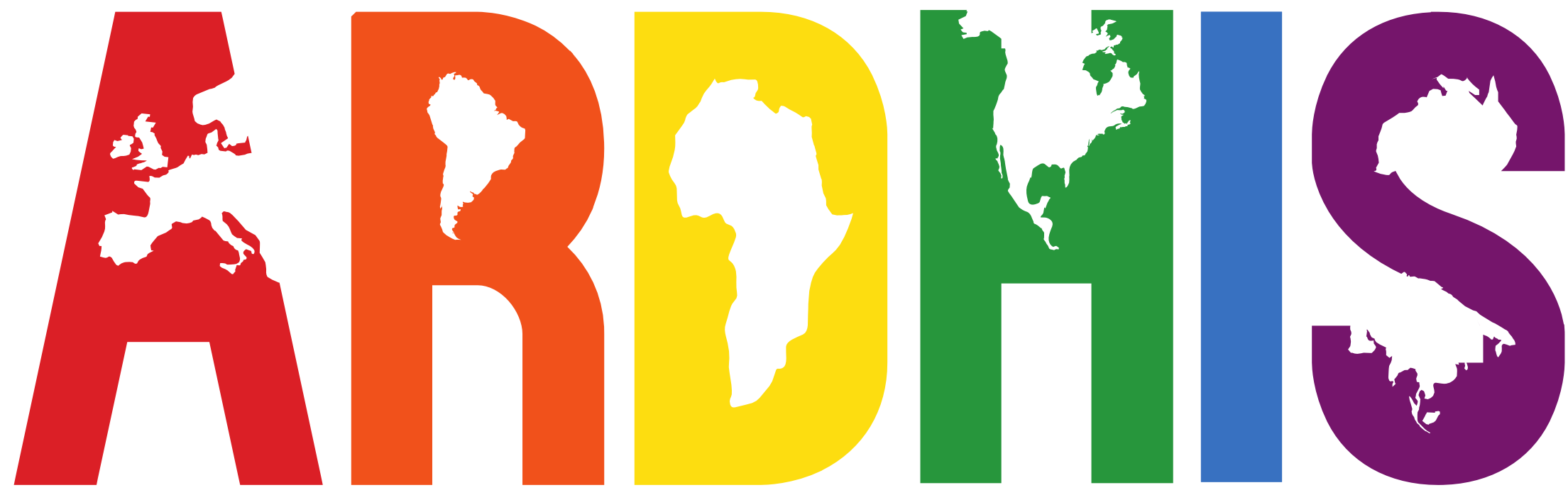Vrai ou faux ? (10/18)

Les lignes directrices et recommandations européennes, et celles du Défenseur des droits (DDD), indiquent qu’il est nécessaire de prendre des précautions lors des entretiens menés avec des personnes LGBTI+, notamment lorsque ces personnes ont vécu des violences en raison de leur genre et/ou de leur orientation sexuelle. La question de l’interculturalité et l’importance de ne pas calquer une vision occidentale des personnes LGBTI+ ou des LGBTphobies est aussi fondamentale.
Ces lignes directrices mentionnent également que la simple affirmation de son genre ou de son orientation devrait suffire. Or, les demandeur·se·s d’asile doivent développer tout leur cheminement de pensée depuis l’enfance et il·elle·s doivent parler de sujets intimes – parfois pour la première fois. Il est dès lors très difficile pour une personne LGBTI+ en demande d’asile de répondre à l’ensemble de ces attentes, surtout car l’appréciation des faits par une vision occidentale est parfois incompatible avec leur contexte culturel et social.
Par exemple, certains mots “neutres” (tels qu’homosexuel·le) n’existent pas dans certaines langues ou dialectes, et les demandeur·se·s d’asile vont donc spontanément avoir recours à des mots qu’il·elle·s ont toujours entendu – même si ces mots sont considérés comme des insultes (ex. “pédé” ou “lélé” pour lesbienne). Les juges peuvent être réticents à l’entendre ainsi, ou l’interprète peut ajouter qu’il s’agit d’une insulte sans pour autant expliquer qu’il n’y a pas d’équivalent “neutre” du mot dans la langue d’origine.
Autre cas de figure, les demandeur·se·s d’asile peuvent n’avoir pas encore pris totalement conscience de leur orientation ou de leur identité de genre, ou il·elle·s ne savent pas comment l’expliquer ou sont en processus d’acceptation. Par exemple, des demandeur·se·s d’asile peuvent se présenter comme des personnes bi dans la mesure où il·elle·s ont été contraint·e·s – pour des questions familiales ou sociétales – à aller contre leurs désirs et avoir des relations avec des personnes du même genre, ce qui peut être une source d’incompréhension pour les officier·e·s de protection ou les juges.
La dernière loi dite “Asile et Immigration” a instauré une territorialisation de la CNDA afin de décentraliser une juridiction actuellement nationale.
Cette territorialisation, qui a commencé à être effective depuis novembre 2024, fait courir différents risques aux demandeur·se·s d’asile LGBTI.
L’unicité de la juridiction garantit actuellement la lisibilité de la procédure de recours par les demandeur·se·s d’asile et sa maîtrise par leurs conseils. L’ARDHIS craint que la territorialisation conduise à une difficulté d’ordre pratique, créant de fait plusieurs entités là où il n’y en a qu’une seule, nationale actuellement, menant à une perte de droit pour les personnes isolées, comme c’est souvent le cas des demandeur·se·s d’asile LGBTI.
RESSOURCES
« La CNDA ouvre ses premières chambres territoriales », CNDA, 4 novembre 2024.
« Formation des acteurs et actrices de l’asile aux vulnérabilités liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. Observations et recommandations », ARDHIS, novembre 2024.